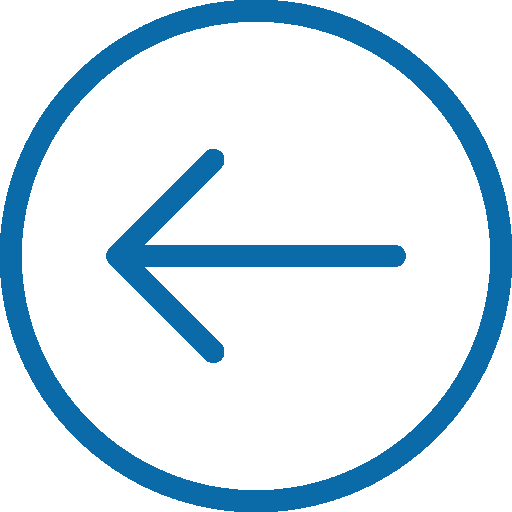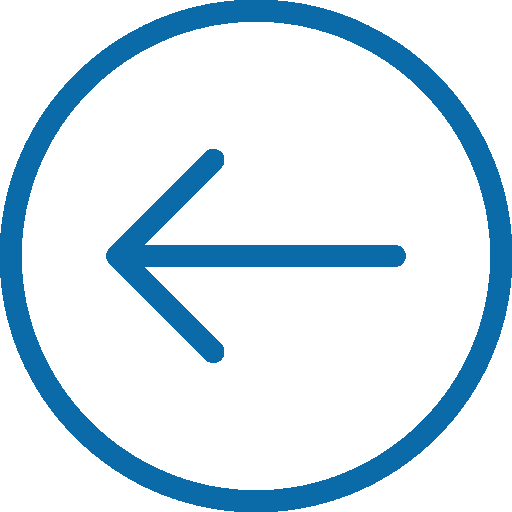

Qu'est-ce que la non-assistance à personne en danger ?
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas venir en aide à une personne qui court un péril imminent. Lorsque les conditions sont réunies, la victime de ce délit peut déposer plainte contre la personne qui ne l'a pas secouru. Elle peut également lui demander une indemnisation. Voici les informations à connaître.
Pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable, plusieurs éléments doivent être réunis :
Une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle. Ce danger peut être dû à l'attitude d'un tiers, du témoin lui-même ou de la personne en danger.
Le témoin a conscience de ce danger
L'assistance apportée à la victime n'expose pas le témoin ou un tiers à un péril
Le témoin s'abstient volontairement de porter assistance à une personne en détresse, d'intervenir pour empêcher un crime ou qu'un délit contre l'intégrité corporelle de la victime, et/ou d'alerter les secours.
Voici 2 illustrations :
Dans le métro, un homme effectue des frottements répétitifs contre le bassin d'une femme qu'il ne connait pas. Une personne est témoin de cette infraction. Il s'abstient d'intervenir et ne prévient pas le personnel de la RATP. Ce témoin peut être poursuivi pour non assistance à personne en danger.
Une femme est coincée dans sa voiture, tombée dans une rivière après un accident. Le courant est fort, l’eau monte rapidement. Le conducteur du véhicule avec lequel cette femme a eu une collision observe la scène, mais ne peut rien faire en attendant les secours. Il est impossible de savoir à qui l'accident est dû : le témoin ou la victime elle-même. Dans les 2 cas, le témoin ne peut pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger car s'il vient en aide à la victime, il s'expose lui-même à un péril.
La victime peut porter déposer plainte contre la personne qui ne lui a pas porté secours alors qu'elle était dans une situation de danger imminent.
 Attention
:
Attention
:
Si elle veut obtenir des dommages et intérêts, elle peut se constituer partie civile lors du dépôt de plainte (ou tout au long de la procédure, jusqu'au jour de l'audience).
La victime peut déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible d'adresser un courrier au procureur de la République.
Le dépôt de plainte doit avoir lieu dans un délai de 6 ans suivant la commission de l'infraction.
 À noter
:
À noter
:
Pour l'aider dans ses démarches, la victime a la possibilité d'être assistée par un avocat. Si elle n'a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à ce professionnel, elle peut demander l'aide juridictionnelle.
La victime peut porter plainte en se déplaçant au commissariat de police ou à la bridage de gendarmerie de son choix.
Où s'adresser ?
La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.
Pour porter plainte auprès du procureur de la République, la victime doit envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
Où s'adresser ?
Dans son courrier, la victime doit préciser les éléments suivants :
Son état civil et ses coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
Récit détaillé des faits, date et lieu de l'infraction
Nom de l'auteur supposé si elle le connaît (sinon, la plainte sera déposée contre X)
Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
Documents de preuve (certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures, etc.)
La victime peut utiliser un modèle de courrier :
Porter plainte auprès du procureur de la République
Ce courrier peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.
Il est également possible de déposer la plainte à l'accueil du tribunal.
Dans tous les cas, un récépissé est transmis à la victime dès que les services du procureur de la République ont enregistré sa plainte.
Par la suite, le procureur de la République a la possibilité d'ouvrir une enquête qui peut aboutir au jugement et à la condamnation de l'auteur de la non-assistance à personne en danger.
L'auteur du délit de non assistance à personne en danger risque des sanctions pénales. Les peines encourues sont plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans.
 À savoir
:
À savoir
:
Si la victime s'est constituée partie civile, la personne qui ne lui a pas porté secours peut également être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
La personne qui s'est rendue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine principale et à des peines complémentaires.
Peine principale
L'auteur du délit de non-assistance à personne en danger encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l'interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'être élu
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une personne devant la justice
Droit de témoigner en justice
Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des contentieux et de la protection et du conseil de famille).
L'interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
 À savoir
:
À savoir
:
L'interdiction du droit de vote et du droit d'être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
Peines principales
Si la victime est un mineur de moins de 16 ans, la personne poursuivie pour non-assistance à personne en danger encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
Peines complémentaires
La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l'interdiction temporaire des droits suivants :
Droit de vote
Droit d'être élu
Droit d'exercer une fonction de juge, d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une personne devant la justice
Droit de témoigner en justice
Droit d'être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des contentieux et de la protection et du conseil de famille).
L'interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.
 À savoir
:
À savoir
:
L'interdiction du droit de vote et du droit d'être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).
L'obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel.
Ainsi, tout professionnel (avocat, enseignant, psychologue, etc.) qui a connaissance de faits de maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles commis sur un mineur ou sur une personne dans l'incapacité de se défendre (exemple : personne âgée) peut en informer le procureur de la République. Par exemple, un enseignant peut dénoncer des faits de viol sur mineur aux autorités pour protéger son élève.
Par ailleurs, lorsque le patient a donné son accord, le professionnel de santé qui le suit (exemple : médecin) peut alerter le procureur de la République des violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui lui sont infligées.
Et aussi
Justice
Travail - Formation
Délit
Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans
Plainte
Acte par lequel une personne qui estime avoir subi un préjudice du fait d'une infraction porte celle-ci à la connaissance du Procureur de la République directement ou par l'intermédiaire d'un service de police ou de gendarmerie
Procureur de la République
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Intégrité physique
Protection du corps humain
Tiers (urbanisme)
Toute personne ayant un intérêt à agir telle qu’un voisin, un mandataire, une association ou un syndicat de copropriétaires
Code de l’urbanisme : article R*600-2
Crime
Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (viol, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, meurtre, assassinat par exemple)
Infraction
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
Dommages et intérêts
Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi
Préjudice
Atteinte subie par une personne envers ses biens (exemple : somme d'argent), son corps, son état psychologique ou son honneur
Peine principale
Peine prévue par la loi pour sanctionner pénalement l'auteur d'une infraction
Peine complémentaire
Sanction qui peut s'ajouter à une peine principale de prison ou d'amende. Exemples : privation des droits civiques (droit de vote et éligibilité...), obligation de soins, retrait du permis de conduire.
Tuteur
Personne désignée pour exercer une mesure de protection d'un majeur ou d'un mineur (par exemple : le représenter dans les actes de la vie courante, gérer ses biens)
Curateur
Personne désignée par la justice pour accompagner une personne majeure dans l'accomplissement de certains actes de la vie civile
Conseil de famille
Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle
RATP
Régie autonome des transports parisiens